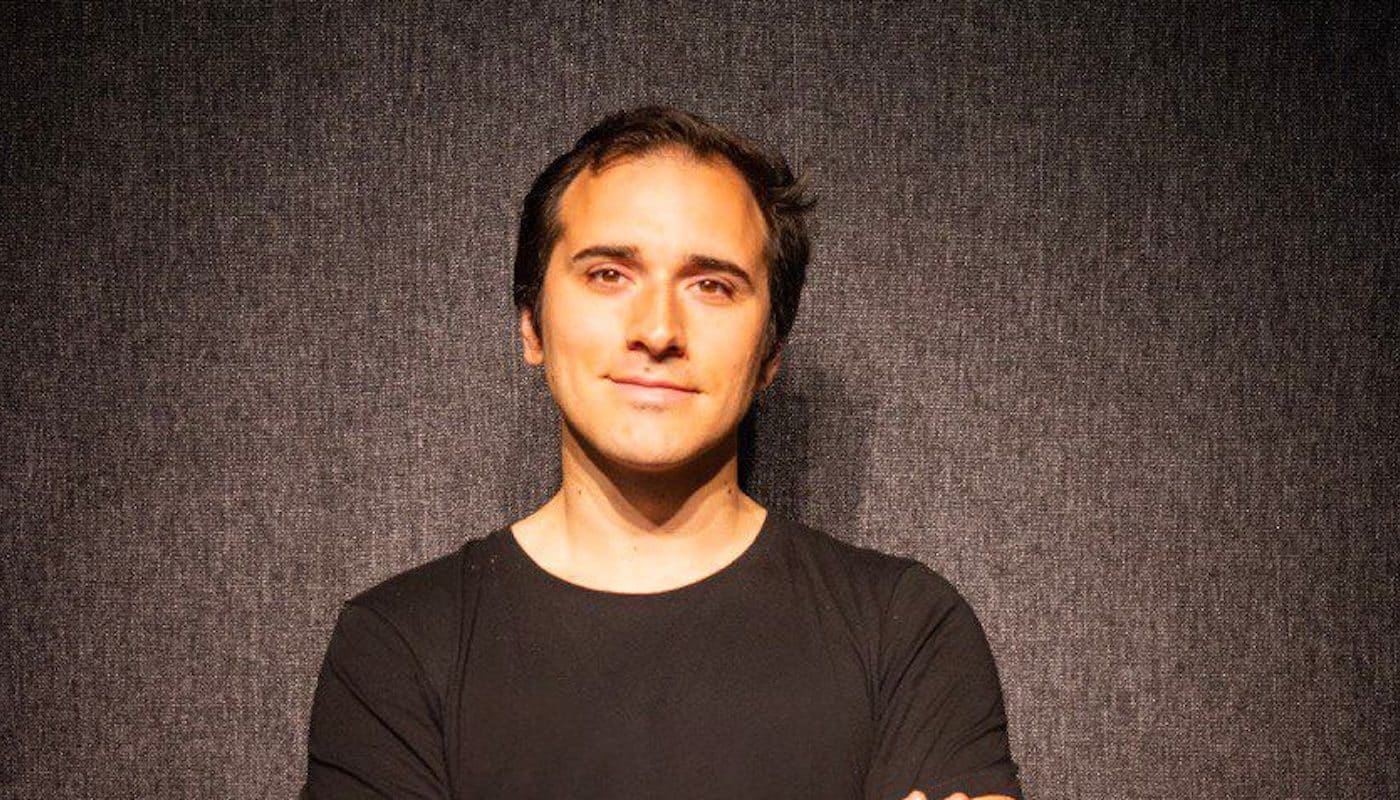Vous avez occupé des fonctions dans deux grandes start-up. L’une britannique et l’autre française. Les deux de dimension internationale. Êtes-vous aujourd’hui confiant pour l’avenir de la FrenchTech, dans un contexte généralisé de baisse des liquidités ?
Il n’y a pas de raison pour qu’en période de resserrement monétaire, dans un contexte où l’octroi de crédits aux particuliers comme aux entreprises se durcit, les fonds alloués aux start-up ne deviennent pas plus compétitifs qu’auparavant. Il s’agit, à mon sens, d’une correction et d’une forme d’atterrissage en douceur permettant d’éviter la formation d’une bulle trop importante, aux effets potentiellement dévastateurs, non seulement sur l’industrie de la tech, mais encore sur l’ensemble de l’économie.
Mais l’environnement global reste solide : beaucoup de start-up ont, avant le retournement du marché, levé des montants conséquents sur des fondamentaux résilients et des indicateurs très positifs, notamment en BtoB. Il ne devrait ainsi pas y avoir de phénomène de désaffection massif.
Inscrivez-vous à la newsletter
En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.
Je pense que l’attractivité du modèle start-up est beaucoup plus importante que lors de la bulle internet et attire des entrepreneurs de qualité en nombre, dès les sorties d’école. Il y a toute une génération d’entrepreneurs ou de cadres dirigeants qui sont passés par l’école Groupon, Uber, Deliveroo, Doctolib, Lydia, etc. Forts de ces expériences similaires à celles de Ben Marrel de Breega, ils essaiment et créent leur propre start-up ou a minima exportent leur expérience dans des start-up plus jeunes. C’est un cercle vertueux de partages d’expérience et de création de synergies qui se traduit par des opportunités d’investissement compétitives pour les fonds de VC.
De nombreuses grandes start-up ont vu, dans ce contexte, leur valorisation chuter drastiquement, jetant un climat d’inquiétude sur l’ensemble de l’écosystème. Est-ce, selon vous, le signe que la valeur de ces acteurs n’était pas assez en adéquation avec la réalité économique ?
Il est certain que, jusqu’en 2022, des multiples déraisonnables ont été utilisés pour des valorisations : plusieurs dizaines de fois l’ARR (NDLR. Revenu annuel récurrent), avec des pertes qui pouvaient être équivalentes. Malgré tout, cela reste une erreur d’analyse de confronter le mode de financement des start-up à une réalité économique classique. Les start-up se positionnent souvent en acteurs de rupture, créent leur marché ou renouvellent des usages sur un marché déjà existant. Et, surtout, il faut aller vite pour dépasser une concurrence et atteindre une masse critique de clients, tout en réussissant à les fidéliser.
Dans ce cadre, la profondeur de leur marché, le taux de repeat ou encore le panier moyen sont compliqués à calculer et font l’objet d’extrapolation sur la base de clients qui sont parfois des ambassadeurs convaincus. Soit le marché se limitait à ces ambassadeurs et la profondeur apparaît finalement insuffisante, soit il explose et l’usage se généralise. Les investisseurs ont eu pleinement conscience de cette réalité et de la notion de risque attachée aux start-up.
Nous n’assistons cependant pas réellement à un tarissement du financement, mais à un resserrement des capacités des VC lié à la conjoncture macro-économique. Cela rend les fonds plus sélectifs et plus attentifs aux indicateurs qui contribuent à leur prise de décision d’investissement. Mais les start-up continuent de créer de la valeur, y compris dans l’économie dite « réelle ».
La crise sanitaire a entraîné une puissante numérisation des usages. La Covid-19 et les mesures l’accompagnant passées, craignez-vous que cette tendance disparaisse petit à petit ? Ou, au contraire, cette crise aura-t-elle servi d’accélérateur de tendances qui ont vocation à s’installer durablement ?
Les usages s’ajustent, et à l’image du resserrement temporaire des financements, cela me paraît une très bonne chose ! Il faut trier le bon grain de l’ivraie et le marché le fait très bien : Doctolib a passé un cap pendant la pandémie, grâce à des fondamentaux sérieux. Le quick commerce aura en revanche été un feu de paille, comme en témoigne la chute du nombre d’opérateurs sur ce marché, désormais presque limité à Flink après le départ de Getir en France, contre une grosse dizaine d’acteurs il y’a deux ans. Bref, la réalité du marché du quick commerce pendant la pandémie n’était pas celle d’une société sans restriction de déplacement. Quel que soit le contexte, les start-up qui créent de la valeur pour leurs clients continueront de se développer.
Après des années dans des start-up, vous souhaitez désormais vous positionner en tant qu’investisseur et dirigeant opérationnel au sein de PME ou TPE. Quels sont, selon vous, les bénéfices d’une expérience en start-up pour repérer les cibles les plus prometteuses ? En matière de gestion de sociétés plus directement ancrées dans l’économie réelle, cette expérience est-elle également bénéfique ?
La recherche de TPE/PME demande d’être autonome et débrouillard. Ce sont finalement deux des qualités les plus indispensables pour exercer dans une start-up. On y cumule aussi plusieurs rôles, ce qui permet d’obtenir une expérience non négligeable dans les fonctions support. C’est essentiel pour l’audit et la conduite de TPE/PME, où l’on trouve aussi un même modèle de frugalité et de polyvalence.
L’expérience en start-up amène par ailleurs à expérimenter des pratiques digitales qui ont un impact positif sur la productivité et le partage de l’information. Les pratiques numériques peuvent devenir un avantage compétitif pour les TPE/PME, qui y sont malheureusement encore trop faiblement acculturées.
Pour finir, les start-up font face aux mêmes difficultés de recrutement que les TPE/PME ; le travail sur la marque employeur, la rétention des salariés, les évolutions de carrière y sont des enjeux tout aussi capitaux.
Les start-up françaises, notamment dans certains secteurs particulièrement stratégiques, comme l’innovation de Défense, sont particulièrement scrutées par les capitaux étrangers. Nous l’avons vu avec le cas Exxelia, qui a entraîné une mobilisation majeure des pouvoirs publics pour protéger le groupe. Considérez-vous que la France soit suffisamment outillée pour assurer sa souveraineté industrielle contre toute forme de prédation étrangère ?
Le cas d’Exxelia est malheureux, mais d’autres cas ont connu une issue bien plus favorable, à l’image de Photonis. Je pense que la France a un arsenal législatif suffisant et d’ailleurs plus développé que beaucoup de nos voisins européens. En revanche, la volonté politique manque parfois pour appliquer les textes.
Mais ce n’est pas le seul facteur : dans une économie de marché, il est normal que les vendeurs attendent un prix compétitif de leur actif. Que le politique exige qu’ils bradent leur entreprise pour la vendre en France et c’est tout l’investissement dans la BITD qui en pâtira. Il est donc nécessaire que les acteurs économiques français se mobilisent aussi sur ces dossiers. Dans ce registre, les politiques RSE et les taxonomies européennes qui excluent la Défense sont plus dommageables qu’un éventuel arsenal législatif défaillant.