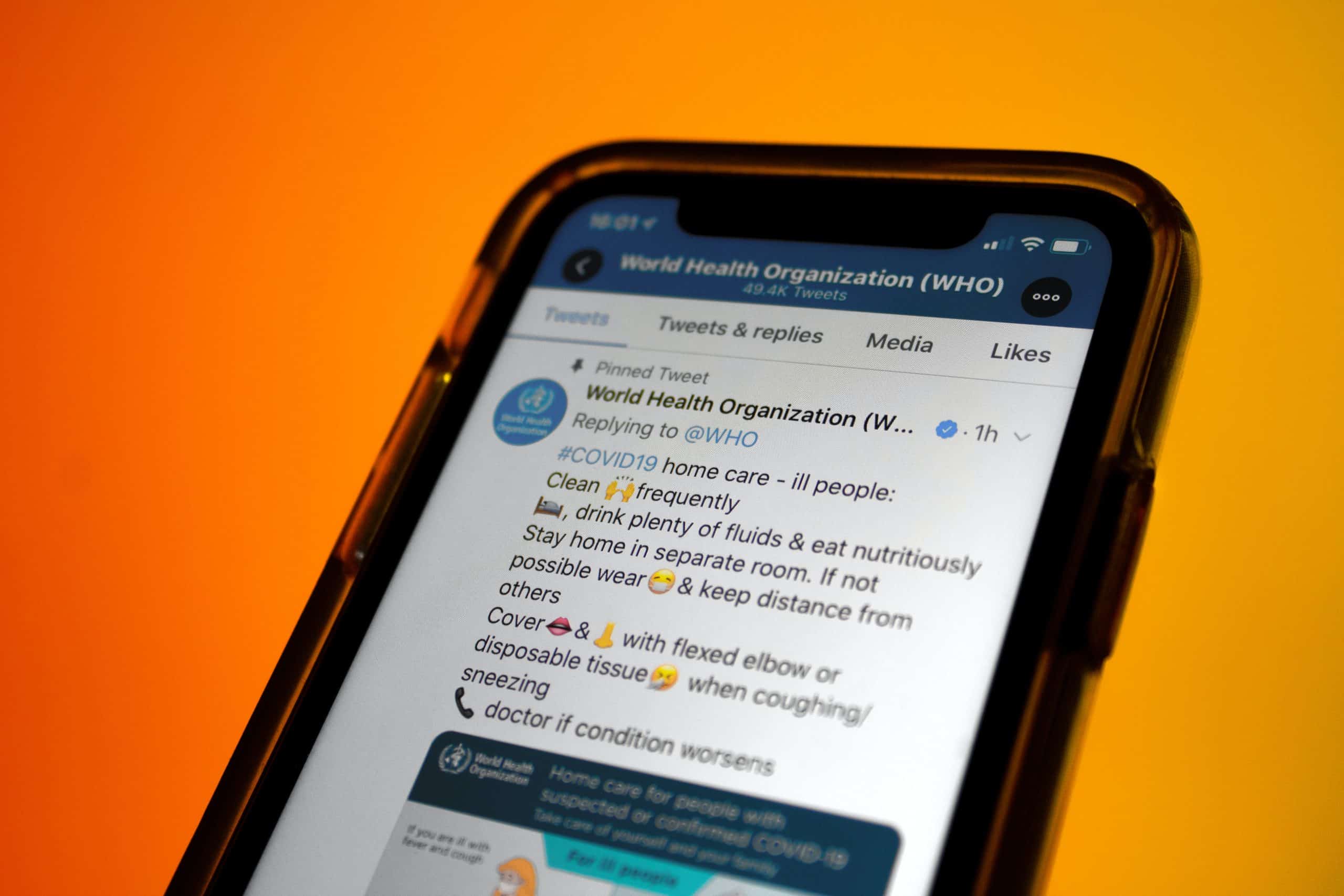Lorsque les pays du monde, tentant de freiner la propagation d’un virus, ont peu à peu déclaré des mesures physiquement contraignantes, la connexion internet est devenue notre meilleure amie. Toutes les activités humaines se sont peu à peu raccrochées au monde numérique : nos commerces, l’école, les consultations chez le médecin, les débats politiques, ou encore les précieuses discussions entre amis. Les réseaux sociaux et médias n’étaient alors plus seulement une distraction ou un devoir citoyen d’information, mais une question d’urgence psychologique, économique et sociale. Internet a été, pour bien des personnes, l’unique moyen de rester en contact avec le monde extérieur et leurs personnes chères, ainsi qu’une source infinie d’information sur la situation sanitaire.
Autant la technologie a pu soutenir la cause des droits humains depuis le début du siècle, notamment via internet et les platesformes de communication, autant elle a le potentiel de les mettre en péril. C’est ce qui a pu être constaté depuis la découverte et la propagation globale du COVID-19. Freedom House a ainsi publié un rapport alarmant sur les restrictions de droits humains grâce à la maîtrise d’internet et des nouvelles technologie, intitulé “L’ombre numérique de la pandémie”.
Inscrivez-vous à la newsletter
En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.
On y apprend que, dans la majorité des pays, la gravité de la pandémie a représenté une justification pour la restriction de certains droits, notamment le droit à l’information, la liberté d’expression, la dignité humaine, la transparence, et la non-discrimination. En vertu du droit international des droits humains, les gouvernements devraient normalement protéger ces droits et non les bafouer, même au nom de la santé publique. Au contraire, nombre d’entre eux ont utilisé et utilisent encore la pandémie comme prétexte pour sévir contre la liberté d’expression et l’accès à l’information. Il est à noter que l’étude conduite par Freedom House l’a seulement été sur 65 pays, parmis lesquel certains n’ont pas été comptabilisés comme usant de techniques de contrôle numérique. La France, l’Australie, le Canada, le Japon ou encore la Grande Bretagne y figurent.
Néanmoins, dans de nombreux pays du monde (pas forcément les plus répressifs), on a cherché à tout prix à maintenir le contrôle et la sécurité de la population à l’aide de restrictions sévères. La censure, les menaces, les sanctions et les outils de surveillance abusifs ont prospéré, excusés par l’urgence sanitaire. L’application de la souveraineté nationale au cyberespace (la “cyber-souveraineté”) a donné aux autorités la liberté de sévir contre les droits de l’Homme tout en ignorant les objections de la société civile et de la communauté internationale.
La construction d’un récit étatique via Internet
La manipulation de l’information et de son accès
La pandémie mondiale l’a démontré : parfois, l’accès à l’information peut influer sur la vie et la mort, et en avoir le dernier mot. En France, la population n’est que trop submergée des rappels de “rester informés” sur la situation environnante, et en contact virtuel avec ses proches. Plusieurs plaintes, émanant de particuliers, ou d’associations et de collectifs, ont été déposées contre des membres du pouvoir exécutif devant la Cour de Justice de la République.
Dans certains pays, les autorités ont dès le début de la pandémie criminalisé les déclarations de presse concurrentes des versions officielles, emprisonnant des journalistes, supprimant des contenus menaçant la légitimité de l’Etat, et prenant le contrôle de l’information sur le territoire.
Le rapport de Freedom House est préoccupant : 28 des 65 pays évalués ont bloqué des sites web et forcé la suppression de contenus. En Chine, où le nouveau coronavirus a été découvert en janvier, les autorités ont rassemblé leurs efforts pour contrôler le discours mondial, et cacher leur réticence initiale à communiquer sur le virus, tout autant que leur gestion discutable de l’épidémie à Wuhan. Ce même rapport nous apprend que les modérateurs chinois ont censuré des millions de contenus contenant plus de 2000 mots-clés liés à la pandémie. Cette censure s’est opérée à la fois sur WeChat, la principale plateforme de communication du pay, et sur YY, une plateforme de diffusion en direct, comme Twitch ou Discord. C’est la “version officielle” qui devait prévaloir sur toutes les autres informations pouvant émaner de recherches indépendantes. Une véritable censure a en ce sens été exercée, l’État essayant de modeler la vérité, en agissant sur sa perception par ses citoyens. Si personne ne la connaît, une vérité est-elle encore vérité ?
La Chine a été pointée du doigt sur la scène internationale pour ses agissements, certes. Pourtant, d’autres pays un peu moins mis en lumière, ont agis de façon similaire. Le rapport de Freedom House évoque par exemple l’Egypte qui, en mars et avril, a bloqué des médias accusés de diffuser de fausses informations, et détenu un journaliste contestant les données officielles fournies par le gouvernement. L’intimidation des organes de presse a été courante durant la pandémie, à l’image du Bangladesh, lui aussi ayant étouffé les reportages dissidents.
Ces comportements sont contraires aux droits humains, et ainsi contraire aux devoirs des gouvernements envers leurs citoyens de garantir une sphère publique sur internet, fiable, dynamique, et critique. Internet ne devrait pas permettre d’ériger des frontières entre les gens, tout comme il ne devrait pas permettre de modeler une vérité scientifique en fonction d’intérêts ou de volonté politique, toujours selon le rapport de Freedom House.

Graphique : Clémence Maquet / Siècle Digital. Source : Freedom House
Le muselage de la liberté d’expression au nom de la désinformation
En plus de dissimuler la vérité, certains gouvernements ont activement prôné le faux, en répandant de fausses nouvelles (les fameuses “fake news”) et en rejetant les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé. Dans de nombreux endroits du monde, comme l’explique le rapport, ce sont des fonctionnaires d’État et leurs partisans zélés qui ont diffusé des informations trompeuses, dans le but de noyer le contenu exact des publications jugées inappropriées. Il a aussi été question de tout bonnement distraire le public des réponses politiques inefficaces, ou pire, d’accuser et exclure, en bon bouc émissaire, certaines communautés ethniques et religieuses.
Au Venezuela, le président de facto Nicolas Maduro a ainsi combiné censure des médias et propagation officielle de fausses affirmations. On a pu entendre de sa part que le virus était une arme bioterroriste, ou encore qu’on pouvait le combattre en buvant du thé à la citronnelle. Il accompagne ainsi le président Loukachenko en Biélorussie sur la liste des figures d’autorité ayant préconisé un remède “fait maison”, ce dernier ayant plutôt conseillé la vodka. En plus d’avoir bloqué la tentative de l’opposition de fournir à la population des données et informations sanitaires, les responsables fidèles à Maduro ont détenu des journalistes qui refusaient de supprimer du contenu dénonçant les conditions dans les hôpitaux, ou des mises à jour sur la propagation du virus.
Ainsi, la pandémie a exacerbé la répression mondiale de la liberté d’expression, en faisant de la critique un affront illégal. Dans au moins 45 des 65 pays couverts par Freedom House, des militants, des journalistes ou des citoyens ont été arrêtés ou inculpés pour des discours en ligne liés au COVID-19. Les autorités ont justifié ces arrestations par une myriade de lois qui criminalisent l’expression, considérée comme source de panique, incitant à la violence, répandant la haine et heurtant l’image du gouvernement.
Dans au moins 20 pays, les gouvernements ont cité explicitement l’urgence de la pandémie afin d’imposer des restrictions supplémentaires de la liberté d’expression. Ces mesures ont ainsi permis de criminaliser la diffusion d’informations ou de contenus «faux» susceptibles de porter atteinte à « l’ordre public ».
L’atout irremplaçable d’internet pour la démocratie
Internet permettant de connecter facilement les personnes à l’information, il a représenté un outil puissant pour informer, conseiller, et connecter les gens entre eux. Le web, depuis le début de la pandémie, n’est plus un outil mais une nécessité. Plus que jamais, le virtuel était réel, depuis la découverte du virus et le début de ses conséquences massives sur les sociétés. Les sociologues le disent depuis des années : le virtuel existe bien comme adjectif, mais pas comme condition de l’Homme.
Internet, en offrant un puissant moyen de socialité et d’être, assure une continuité entre notre identité en ligne et hors ligne. De plus, l’accès à Internet est un droit de l’Homme internationalement reconnu, et les perturbations du réseau cette année constituent une forme particulièrement cruelle de punition. En influant sur son accès, les gouvernements ont fait bien plus que tailler une part de notre identité. Les restrictions de connectivité et les manipulations de l’information par les autorités dans certains pays, à long terme, ont laissé certaines populations ignorantes du virus et des précautions à adopter, les mettant tout bonnement en danger.
En Hongrie, où la liberté d’Internet n’avait pas encore été trop affectée malgré un déclin précipité de la démocratie au cours des dernières années, le gouvernement a introduit des dispositions restreignant la liberté d’expression en ligne. Le pays a en effet mis en place une peine de cinq ans de prison pour la publication d’informations fausses ou déformées sur la pandémie, franchissant une nouvelle étape vers l’autoritarisme, cette-fois numérique.
La pandémie, passe-partout de l’État omnipotent
L’ère de l’hyper-surveillance
Les autorités de nombreux États du monde ont pris en prétexte le COVID-19 pour justifier de l’élargissement des pouvoirs de surveillance et du déploiement de nouvelles technologies autrefois considérées comme intrusives. La crise de santé publique a ainsi créé une ouverture pour la numérisation, la collecte et l’analyse des données les plus intimes de personnes n’ayant pas la protection adéquate contre ces abus.
Des applications pour smartphone ont été déployées pour le traçage des contacts dans au moins 54 des 65 pays couverts par le rapport Freedom House. Bien que ces applications puissent permettre aux individus d’identifier plus facilement avec qui ils ont interagi et modérer les contagions, leur déploiement rapide et leur omniprésence présente un risque pour la vie privée, la sécurité personnelle, et les droits humains en général.
Pourquoi cela ? Car, dans l’urgence, le rapport indique que les développeurs ont largement ignoré les principes établis en matière de confidentialité, et peu d’applications ont subi des examens tiers vérifiant le respect des droits humains dans la pratique. Les processus impliqués ont ainsi souvent manqué de transparence, de contrôle indépendant et de voies de recours.
C’est le cas notamment d’Aarogya Setu (Le pont de la Santé) en Inde, qui utilise à la fois le bluetooth et le GPS pour déterminer l’exposition des citoyens au virus. Plus d’un million d’indiens ont été forcé de l’utiliser, avec dans une ville la présence de poursuites pénales si on ne l’avait pas téléchargé. Les informations collectées à partir de l’application soutenue par le gouvernement ont été stockées dans une base de données centralisée, et partagées avec les instituts de santé et d’autres agences gouvernementales, violant la vie privée de ses utilisateurs. Un autre abus indien en termes de vie privée des utilisateurs a été l’application Quarantine Watch, qui collecte et stocke des informations personnelles, y compris des données GPS. L’application obligeait les utilisateurs à envoyer des photos d’eux-mêmes accompagnées de métadonnées sur leur géolocalisation pour prouver qu’ils respectaient bien la quarantaine obligatoire.
Le rapport pointe ainsi que les gouvernements et les entités privées ont intensifié leur utilisation de l’intelligence artificielle (IA), de la surveillance biométrique, et des outils de mégadonnées (big data) pour “assurer l’ordre” et prendre des décisions qui affectent les droits économiques, sociaux et politiques des individus.
Les données, le nouvel or noir
La recherche des contacts est, comme on l’a dit, vitale pour gérer une pandémie. Cependant, les programmes de surveillance numérique, qui peuvent balayer beaucoup plus d’informations que les tests et le traçage manuels, ont été mis en oeuvre de manière douteuse pendant la pandémie.
Dans au moins 30 pays des 65 examinés dans le rapport de Freedom House, les gouvernements ont utilisé la pandémie pour s’engager dans une surveillance de masse, en partenariat direct avec des fournisseurs de télécommunications. Ces entreprises de télécoms leurs ont principalement fourni des données qui aident les autorités à analyser la propagation du virus. Les données, plus qu’elles ne l’étaient déjà, sont devenues le nouvel or noir.
Au Pakistan, le gouvernement a par exemple réutilisé un système anti-terroriste pour tracer la population pendant la crise du COVID-19. Le programme secret avait été développé par l’agence Inter-Services Intelligence (ISI), impliquée dans des disparitions forcées et d’autres violations flagrantes des droits de l’Homme. Il permettait au «geofencing» d’identifier toutes les personnes qui avaient traversé une zone spécifique à un moment précis grâce aux données récoltées.
En Corée du Sud, la loi sur le contrôle et la prévention des maladies infectieuses (IDCPA) a aussi permis une large surveillance, soulevant des questions sur sa nécessité et sa proportionnalité aux nombre de cas du pays. Les responsables ont extrait des informations des enregistrements de cartes de crédit, du suivi de l’emplacement du téléphone, ou encore des caméras de sécurité – le tout sans ordonnance du tribunal – et les ont combinées avec des entretiens personnels avec les citoyens, pour une recherche rapide des contacts et une surveillance des infections réelles et potentielles.
L’amplification des conflits existants et leurs conséquences sanitaires
Dans certaines régions du monde, les restrictions de libertés liées à la pandémie ont visé particulièrement durement des groupes ethniques et religieux spécifiques que le gouvernement cherchait déjà à exclure. Comme le relate le rapport Freedom of the Net, au Myanmar (un des pays qui a subi la plus forte chute de son score de liberté sur internet), le service Internet mobile était déjà bloqué depuis juin 2019 pour plus d’un million de personnes vivant dans des villages des États de Rakhine et Chin, peuplés des Rohingyas persécutés par l’armée.
Au début de l’épidémie, en mars, les autorités ont aussi bloqué les sites d’information régionaux permettant d’obtenir des conseils basiques pour se protéger, marginalisant davantage ces populations déjà victimes de violations des droits de l’homme de la part du régime. Ces actes de la part du gouvernement ont mis en danger les résidents, limitant leur capacité à apprendre l’existence du virus, puis à obtenir des informations sur sa propagation. Dans les camps de réfugiés Rohingyas se trouvant au Bangladesh, même situation, avec un manque d’accès à internet et aux informations basiques de sécurité.
L’accélération de la course à la cyber-souveraineté est-elle compatible avec la coopération internationale ?
Comme le COVID-19 l’a démontré, relever les défis d’un monde interconnecté nécessite une coordination efficace entre les décideurs et la société civile de tous les pays. Les nouvelles institutions construites pour l’ère numérique pourraient gérer des problèmes transnationaux, internet n’ayant pas de frontières, après tout. Une coopération efficace à l’échelle globale permettrait de gérer ces enjeux de droits humains et violations, les États ayant au nom du droit international une “responsabilité à protéger” valable au delà des frontières.
Selon le rapport, seule une action collective et transnationale permettra de contrer les abus des gouvernements commis aux quatres coins du monde. De plus, cela permettrait de freiner l’élan du nouvel état de surveillance par l’IA. Puisque que les entreprises, les agences de sécurité, et les bureaux gouvernementaux en viennent à s’appuyer sur la technologie numérique (avec tous ses défauts), il y a dès lors un risque que la technologie elle-même devienne effectivement l’autorité, plutôt qu’un outil utilisé pour mettre en œuvre des décisions humaines et protéger.
Responsabilisant, le rapport insiste sur le rôle que chacun peut jouer dans le dessin de l’avenir de la technologies et de ses usages, en plus des États. L’avenir de la vie privée et des autres droits fondamentaux dépend de ce que nous en ferons, à partir de maintenant. Dans le monde, à mesure que les écoles rouvrent, les gens retournent au bureau et les voyages reprennent malgré la pandémie en cours. Il est probable que la pression pour les applications mobiles, la technologie biométrique et les passeports de santé ne fera que croître, entre bien d’autres choses.
Cependant, il est vital pour le citoyen de se demander si certaines nouvelles formes de surveillance sont nécessaires et souhaitables dans une société démocratique. Il est sensé de penser quelques secondes aux promesses exagérées des promoteurs d’outils de haute technologie, et de pousser les élus à mettre en place de solides protections de la vie privée et autres garanties dans la loi, comme elle pourraient bientôt exister en Europe.
Freedom House finit sur ce constat : les pays, individuellement, peuvent bien prendre les devants, mais seule une action combinée d’individuel et de collectif à l’échelle mondiale peut faire reculer les excès actuels de la nouvelle “cyber-souveraineté” accentuée par la pandémie.